Pourquoi fabriquer des images ? Analyse, plan et exemple de 3ème partie rédigée
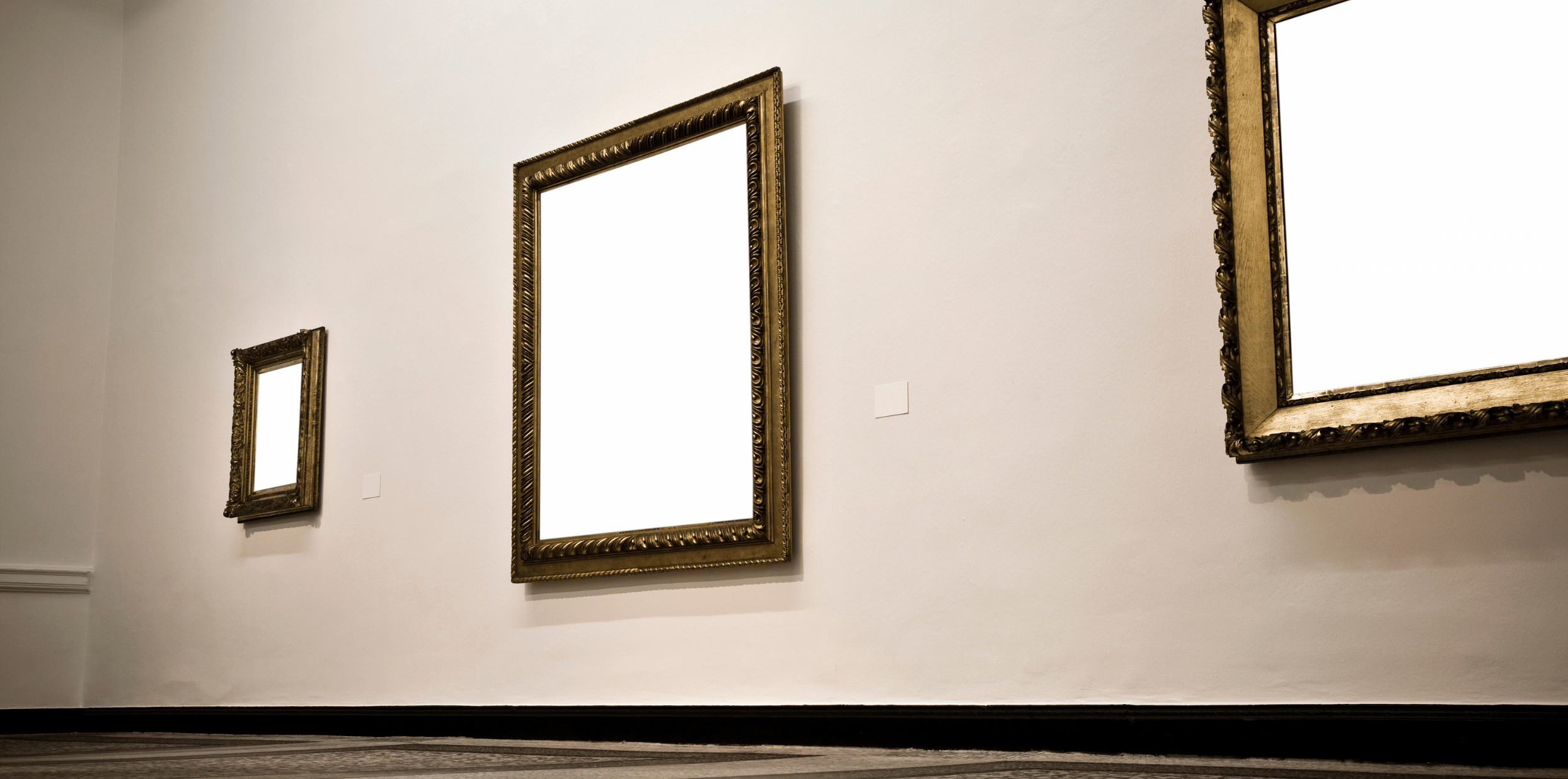
What makes a good brand book?
Sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim facilisis gravida. Diam phasellus vestibulum lorem sed risus ultricies. Magna sit amet purus gravida quis blandit. Arcu cursus vitae congue mauris. Nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et leo. Semper risus in hendrerit gravida rutrum quisque non. At urna condimentum mattis pellentesque id nibh tortor. A erat nam at lectus urna duis convallis convallis tellus. Sit amet mauris commodo quis imperdiet massa. Vitae congue eu consequat ac felis.
- Lorem ipsum dolor sit amet consectetur hendrerit gravida rutrum.
- A erat nam at lectus urna duis convallis convallis tellus.
- Arcu cursus vitae congue mauris mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et leo.
- Magna sit amet purus gravida quis blandit cursus congue mauris mattis enim.
How to create a good brand book?
Vestibulum lorem sed risus ultricies. Magna sit amet purus gravida quis blandit. Arcu cursus vitae congue mauris. Nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et leo. Semper risus in hendrerit gravida rutrum quisque non.

Important elements of a good design brand book
Eget aliquet nibh praesent tristique magna sit amet purus. Consequat id porta nibh venenatis cras sed felis. Nisl rhoncus mattis rhoncus urna neque viverra justo nec. Habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac. Et tortor consequat id porta nibh venenatis cras sed felis. Fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi. Mi sit amet mauris commodo quis. Eget arcu dictum varius duis at consectetur lorem.Venenatis cras sed felis eget velit
- Magna eget est lorem ipsum dolor.
- Enim lobortis scelerisque fermentum dui. Fringilla ut morbi tincidunt augue.
- Nascetur ridiculus mus mauris vitae.
- Egestas sed tempus urna et pharetra pharetra massa massa ultricies.
What brand book references can I use?
Mattis molestie a iaculis at. Volutpat est velit egestas dui id. Suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus. Aliquet nibh praesent tristique magna sit amet purus gravida. Volutpat blandit aliquam etiam erat velit scelerisque in dictum. Potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare suspendisse sed. Aliquet bibendum enim facilisis gravida neque convallis. Malesuada nunc vel risus commodo viverra maecenas. Varius sit amet mattis vulputate enim.
“Arcu cursus vitae congue mauris mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et leo nullam ac tortor”
A brand book can always keep evolving
Egestas quis feugiat urna, tincidunt ut sem sit in ipsum ullamcorper etiam varius turpis tincidunt potenti amet id vel, massa purus arcu lectus scelerisque quisque velit cursus et tortor vel viverra iaculis ornare feugiat ut cursus feugiat est massa, blandit quam vulputate facilisis arcu neque volutpat libero sollicitudin sed ac cursus nulla in dui imperdiet eu non massa pretium at pulvinar tortor sollicitudin et convallis senectus turpis massa bibendum ornare commodo eu scelerisque tristique justo porttitor elit morbi scelerisque facilisis
Définition des termes du sujet
Pourquoi : La question suggère une recherche de finalité, mais aussi une interrogation sur la nécessité. Deux sens donc : les causes historiques et psychologiques qui ont poussé l’humanité à fabriquer des images et les fonctions et impacts des images dans notre société d’aujourd’hui.
Fabriquer : "fabriquer" implique une intervention humaine, une intentionnalité et un travail de transformation. Ce terme suppose donc aussi un artifice, l’image est une construction et non une chose matérielle ou immatérielle brute.
Plan détaillé
I. L’image comme un besoin fondamental de l’homme pour connaître et s’approprier le monde
A. L’image comme médiation entre l’homme et le réel
B. L’image comme instrument de pouvoir et d’influence
C. L’image comme pouvoir d’appropriation du réel
Transition avec II :
Si l’image est un outil de compréhension et d’appropriation du monde, elle n’est pas neutre. Elle peut aussi nous détourner du réel en instaurant une illusion, une fausse réalité qui éloigne l’homme de la vérité.
II. L’image comme écran entre l’homme et le réel, un piège illusionniste
A. L’image comme illusion et falsification du réel
B. L’image comme aliénation et perte de liberté
Transition avec III :
Si l’image peut nous enfermer dans une illusion, elle n’est pas pour autant un simple leurre. Elle peut aussi être un outil d’émancipation, une manière pour l’homme de dépasser sa condition et de se réinventer.
Proposition de 3ème partie rédigée
III. Une intervention humaine nécessaire à notre condition humaine et dans la finalité d’exister
A. L’image comme construction d’une humanité partagée
Exemple philosophique : L’Imaginaire, Sartre : l’image n’est pas un simple reflet du réel, mais une création active de la conscience. L’homme, par nature, dépasse le donné immédiat en imaginant d’autres réalités possibles. La fabrication d’images est donc un processus fondamentalement humain qui permet d’exprimer des aspirations collectives et d’inventer des récits qui unissent.
Exemple littéraire : dans L'Être et le Néant, Jean-Paul Sartre utilise l'exemple du garçon de café pour illustrer un concept central de son existentialisme. Même si sa vision est plutôt à charge sur l’image que cherche à fabriquer le garçon de café, force est de constater qu’il existe en tant qu’être-pour-autrui.
« Son mouvement est rapide et précis, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs avec un pas un peu trop prompt. Il s’incline avec une complaisance un peu trop étudiée, sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop attentif à l’ordre du client. »
C’est par la fabrication intentionnelle de cette image (voire de ce masque) qu’il peut exercer son rôle et construire sa place dans la société.
Transition avec B : L’homme est un être libre, mais il peut être tenté de fuir cette liberté en acceptant de n’être qu’une image, un rôle social, une fonction qu’il fabrique. Sartre nous invite donc à refuser cette réduction, à assumer notre existence comme un perpétuel dépassement de nous-mêmes.
B. L’image comme dépassement de la finitude humaine
L’homme est un être voué à la mort, et c’est précisément cette finitude qui le pousse à fabriquer des images pour lutter contre l’oubli. L’image devient un acte de résistance face au néant, une tentative d’inscrire dans le temps ce qui, autrement, se dissoudrait dans l’éphémère.
Exemple philosophique : Dans L’Origine de l’œuvre d’art, Heidegger ne considère pas l’art comme une simple représentation du monde (comme un miroir fidèle du réel), mais comme un acte fondamental qui instaure un monde, c'est-à-dire une manière d’être et de se rapporter à l’existence. L’œuvre d’art met en tension l’être et l’oubli.
Heidegger prend l’exemple du temple grec. Ce dernier n’est pas qu’un objet architectural, il crée un monde. Il définit un espace sacré, structurant le rapport des hommes aux dieux et au cosmos. Il résiste à l’usure du temps en tant que trace d’une civilisation disparue, permettant aux hommes d’aujourd’hui d’accéder à ce monde ancien. De la même manière, fabriquer des images, c’est instituer un monde qui transcende le temps et la simple matérialité des choses, leur donnant un sens durable.
Exemple littéraire : Dans À la recherche du temps perdu, et plus précisément dans Le Temps retrouvé, Proust développe l’idée que les sensations peuvent raviver des souvenirs profondément enfouis, en dehors du cadre volontaire et rationnel de la mémoire. Il parle de mémoire involontaire avec les exemples de la madeleine et du pavé inégal. Lorsque le narrateur trempe une madeleine dans du thé, le goût ravive en lui l’univers entier de son enfance, de manière fulgurante et absolue. De même, en marchant sur un pavé inégal, il retrouve la sensation exacte qu’il avait eue dans son passé, ce qui provoque une réminiscence totale du lieu et de l’instant. Ces moments montrent que les images et les sensations sont des ponts entre le passé et le présent, et que la mémoire, en tant que processus, peut être un moyen de lutte contre l’oubli et la finitude. C’est un acte de résistance au temps, d’inscription dans l’être finalement bien volontaire de notre part.
Autre idée à explorer dans cette partie : La fabrication des images dépasse la finitude humaine car elle est aussi un accès au surnaturel et à l’invisible. Au surnaturel par la magie ou la science-fiction, à l’invisible par l’imagerie médicale.
Transition avec C : Loin d’être une simple reproduction du monde, l’image est un lieu de métamorphose : en fabriquant des images, nous ne nous contentons pas de nous représenter nous-mêmes, nous nous transformons nous-mêmes. L’homme par cet acte de résistance ne peut pas rester indifférent, il change et il se fabrique autant qu’il fabrique des images.
C. L’image comme lieu de métamorphose de l’homme
Référence contemporaine : Dans L’Image-Temps, Gilles Deleuze analyse le cinéma comme un espace de transformation, non seulement du récit mais aussi du spectateur et de sa perception du monde. Contrairement à une vision classique du cinéma où les images se succèdent pour raconter une histoire, Deleuze montre que le cinéma moderne (après la Seconde Guerre mondiale) bouleverse cette logique et propose une nouvelle expérience du temps et de l’espace. Deleuze distingue deux grandes manières de concevoir l’image cinématographique. L’image-mouvement (cinéma classique) : basée sur la narration, la cause et l’effet, la progression logique des événements (ex. Hollywood classique, cinéma d’action). L’image-temps (cinéma moderne) : déstructuration du récit, primauté de la perception et de l’expérience du temps sur l’action. L’analyse de Deleuze nous montre que fabriquer des images ne revient pas à fixer un sens, mais à ouvrir un espace de transformation et de perception nouvelle. Chaque image porte en elle une puissance de métamorphose, tant pour celui qui la crée que pour celui qui la reçoit.
Référence littéraire : L’œuvre d’Ovide, Les Métamorphoses, est une somme de récits où le changement de forme est au cœur du processus narratif. Dieux, héros et simples mortels passent d’un état à un autre, incarnant l’idée que le monde est en mouvement constant, que rien n’est figé et que toute identité est susceptible d’évoluer. L’histoire de Daphné et Apollon est un bon exemple : Daphné, poursuivie par Apollon, refuse l’emprise du dieu et préfère se métamorphoser en laurier. Ce changement n’est pas une disparition, mais une résistance, une reconfiguration du réel où elle continue d’exister sous une autre forme. Comme chez Deleuze, Ovide nous enseigne que l’image n’est pas statique mais un processus vivant. Elle permet d’accéder à une autre manière d’être : elle ne fige pas, mais transforme. Dans les deux cas, fabriquer des images, c’est créer du mouvement, ouvrir un espace où l’homme se réinvente sans cesse. Loin d’être un simple reflet du réel, l’image est un moteur du devenir humain.
Conclusion
Si nous avons besoin de fabriquer des images, ce n’est donc pas simplement pour nous sentir humains, mais parce que l’image est constitutive de notre condition même. Elle est ce qui nous relie à l’invisible, ce qui nous délivre de la finitude, et ce qui nous permet d’évoluer au-delà de nous-mêmes. Sans images, nous serions prisonniers de l’immédiateté, incapables de nous projeter au-delà de notre simple existence matérielle. En fabriquant des images, nous nous fabriquons nous-mêmes, et c’est en cela que réside notre irréductible humanité.







